Pour la plupart des personnes qui pratiquent l’entraide de façon spontanée et sans organisation particulière, il peut sembler surprenant de se poser la question de la valorisation du temps d’entraide, voire même de se préoccuper de réciprocité.
Un ami viticulteur vous invite à participer à une demi-journée de vendanges, vous vous faites une joie de participer sans vous soucier du nombre d’heures que cela représentera, ni de la contrepartie que vous recevrez en échange (peut-être un goûter convivial ou quelques bonnes bouteilles de la cuvée précédente).
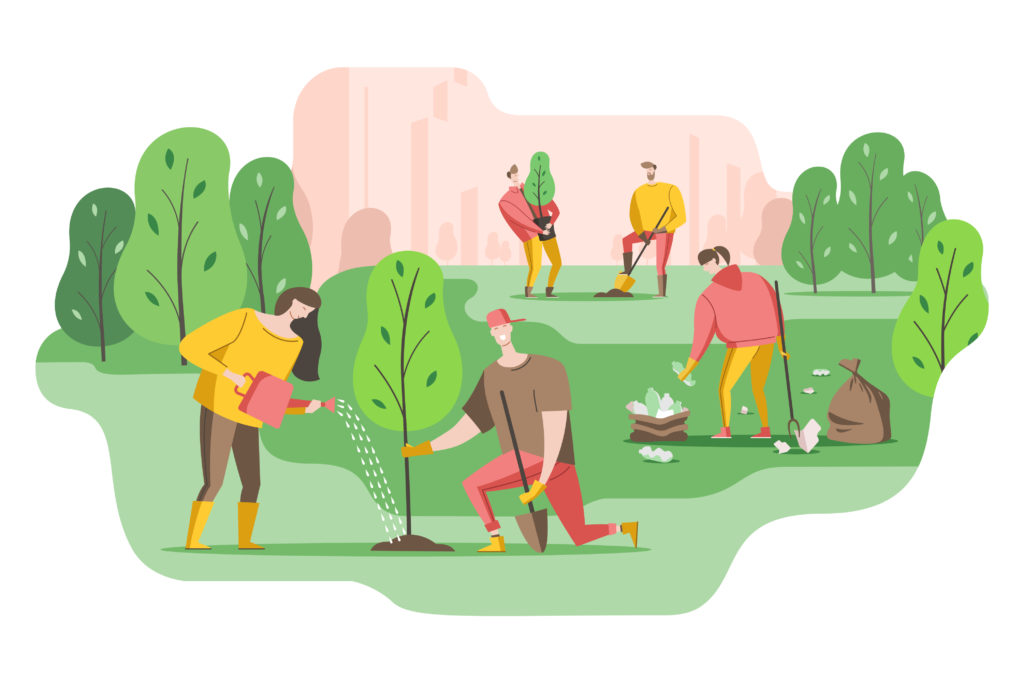
De toute évidence, dans la plupart des situations d’entraide ponctuelle rencontrées entre particuliers d’une part et entre particuliers et agriculteurs d’autre part, le besoin de préciser les choses avant existent peu ou pas, et le fait de garder une trace des événements après leur déroulement ne paraît pas utile.
Il existe ainsi une « entraide libre » qui prend tout son sens dans une forme de consentement donné sans accord préalable sur les conditions de l’entraide. L’engagement pris de « venir aider » est d’ailleurs réversible, à condition de prévenir, et le non-respect de ce qui était convenu ne porte pas à conséquence.
« L’entraide spontanée qui se pratique actuellement dans le champ des activités nourricières vit une sorte de complexe et reste trop peu visible »
François Fuchs, co-fondateur de l’association Entraide nourricière
Des contextes voient le jour où il est question d’adopter de nouvelles pratiques d’entraide. Là où certaines attentes et certaines conditions sont réunies, suffisamment déterminantes et motivantes pour que des personnes volontaires veuillent s’entraider, il semble nécessaire de se donner le temps de s’entendre préalablement sur un échange de biens ou de services, et d’enregistrer simultanément cet échange afin qu’il soit pris en compte collectivement.

Il semble ainsi utile de se placer dans une perspective d’entraide « consciente », a priori dans un cadre collectif, avec les fondamentaux que sont le volontariat et le consentement mutuel. Il s’agit alors de marquer deux étapes cruciales : le temps de la négociation et le temps de la valorisation.
C’est l’orientation choisie dans le cadre du Projet Kiwano pour l’entraide nourricière :
Où par « négocier » nous entendons cette démarche consistant à entrer en relation pour s’entraider, choisir le don sans contrepartie ou définir les contreparties, préciser ainsi ce qui va être échangé, quantitativement et qualitativement, et conclure une entente.
Et où par « valoriser » nous entendons la suite possible, restant optionnelle, permettant de garder en mémoire et de comptabiliser les activités d’entraide, en étant capable d’estimer les impacts de celles-ci, principalement en termes d’économie collaborative, d’économie circulaire, et de services environnementaux rendus.
L’entraide nécessite un temps ou plusieurs personnes (au moins deux) s’entendent sur ce qui se joue
L’entraide nourricière qui est à portée de notre main se situe dans ce périmètre, avec la volonté assumée de développer l’entraide « consciente » dans les contextes et les collectifs où elle est attendue comme une solution, sans que cela se fasse au détriment des formes « libres » de l’entraide.
Cela nous semble d’autant plus utile de tracer l’entraide lorsqu’elle met en jeu des relations d’apprentissage. L’entraide nourricière est souvent « apprenante », c’est à dire que les échanges de biens et de services s’accompagnent d’échanges de connaissances et de retours d’expériences. La formation de pair à pair, entre deux personnes plus ou moins expérimentées qui pratiquent une activité nourricière, est bien une forme d’entraide et ouvre la voie à la montée en compétences.
« Certaines formes d’entraide nourricière méritent aujourd’hui un accompagnement, une reconnaissance, voire une valorisation »
François Fuchs, co-fondateur de l’association Entraide nourricière
Cette proposition d’entraide nourricière volontaire et apprenante portée par le Projet Kiwano (une expérimentation dans le champ de l’innovation sociale) s’attache donc à faire entrer de nouvelles personnes dans le champ des activités nourricières avec le levier de l’entraide.
S’il y a bien un objectif qu’il ne faut pas perdre de vue, c’est l’accueil de nouvelles personnes et leur accès à de nouvelles coopérations, pour tisser ces relations de confiance sur lesquelles reposera en grande partie notre capacité nourricière de demain.


